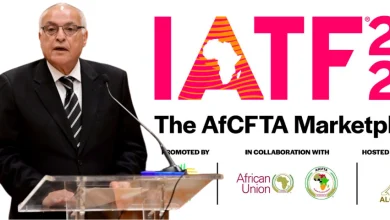IATF 2025 à Alger : vers une intégration économique africaine renforcée
L’Algérie, interface géoéconomique entre la Méditerranée et l’Afrique

Alors que la Foire Commerciale Intra-Africaine (IATF 2025) touche à sa fin à Alger, cette tribune du Dr Arslan Chikhaoui revient sur les enjeux géostratégiques, économiques et diplomatiques de cet événement majeur pour le continent. À travers une analyse fine, l’auteur décrypte comment l’Algérie affirme sa place au cœur de l’intégration économique africaine et renforce son rôle de passerelle entre la Méditerranée et l’Afrique subsaharienne.
Dr. Arslan Chikhaoui, Expert en Relations Internationales et Géopolitique et est Membre du Comité d’Experts Track-2 du système des Nations Unies (UNSCR-1540) et Membre du Conseil d’Experts du World Economic Forum
Contribution: Dr Arslan Chikhaoui
Alger accueille depuis le 4 septembre 2025 la 4e édition de la Foire Commerciale Intra-Africaine (IATF). Cet événement continental majeur, qui se tient sous le thème « Passerelle vers de nouvelles opportunités », a mobilisé des acteurs économiques et institutionnels du pays hôte. L’Agence Algérienne de Promotion de l’Investissement (AAPI) a confirmé un portefeuille de 175 intentions de partenariat en cours de finalisation, pour un montant totalisant plus de 44 milliards USD. Ces discussions avancées entre opérateurs algériens et africains sont en voie de concrétisation à travers des signatures d’accords et de MOU, marquant le début d’une nouvelle ère pour les échanges commerciaux intra-africains.
Depuis une semaine, Alger, ville hôte de l’IATF organisé par AFREXIMBANK et WAIPA, s’est transformée en hub de rencontres B2B pour commencer à construire une confiance (Build Trust and Confidence) et transformer en réalité concrète les ambitions de la Zone de Libre-Échange Continentale Africaine (ZLECAF). En effet, l’Algérie, pour l’organisation de cet événement continental, a déployé sa diplomatie institutionnelle et non institutionnelle (Track-2 Diplomacy), économique et de réseautage (Networking Diplomacy). La participation exceptionnelle de délégations officielles de 140 pays, de plus de 2000 entreprises, ainsi que de 30 agences et institutions financières internationales, témoigne de l’importance hautement stratégique de ce rendez-vous continental. Selon nombre d’observateurs nationaux et étrangers, en termes de standards d’organisation, cet événement n’a rien à envier à un événement de type World Economic Forum.
Par ailleurs, l’interaction entre les politiques, les élites gouvernantes et les acteurs économiques s’est révélée directe, franche et transparente, sans barrières protocolaires rigides. D’ailleurs, les chefs d’État et de gouvernements africains ont participé à des panels dédiés, animés en personne par le président algérien Abdelmadjid Tebboune, sans compter le fait que ces chefs d’État africains, y compris le président Tebboune, ont passé toute une journée en interaction avec la communauté d’affaires et financière présente au Forum. Du point de vue de l’analyse, cela témoigne de la volonté politique des élites gouvernantes de s’engager sérieusement dans ce processus d’intégration économique du continent africain et de dynamiser cette « Aire d’intérêt commun », au moment où les regroupements continentaux plurilatéraux s’organisent ici et là, et où une recomposition des alliances se profile. Incontestablement, nous assistons à une véritable prise de conscience (wake-up call) des élites dirigeantes pour faire évoluer leur mode de gouvernance et s’appuyer de plus en plus sur les acteurs de la société civile. À travers cet événement, nous percevons une véritable volonté d’émancipation économique et politique des pays africains en général, et de l’Algérie en particulier.
En somme, la tenue à Alger de cet événement à haute connotation géostratégique marque la réaffirmation de l’appartenance de l’Algérie à son espace naturel qu’est la Méditerranée, avec sa profondeur stratégique subsaharienne et africaine. En effet, l’Algérie développe et consolide ses traités d’amitié, de voisinage et de coopération ainsi que ses partenariats stratégiques avec les pays du bassin méditerranéen, et concomitamment s’active à catalyser la dynamique économique et politique continentale africaine. Incontestablement, l’Algérie s’emploie de ce fait à s’ériger en interface stratégique en Méditerranée occidentale.
Adaptabilité à la nouvelle cartographie géopolitique multipolaire
- Eléments de contexte
La crise pluridimensionnelle qui touche l’ensemble de la planète a pour effet : une inflation exponentielle, des perturbations de la chaîne d’approvisionnement alimentaire et énergétique, des déplacements de populations vulnérables et des risques migratoires élevés ainsi que le développement de la grande criminalité urbaine, nationale et transnationale. Les pays émergents et en développement, en particulier, sont confrontés à une triple menace : crise alimentaire, crise du carburant et climatique et crise financière (avec la hausse des taux d’intérêt). La politique Zéro Covid en Chine qui a réduit la croissance de la deuxième économie mondiale et la hausse des taux d’intérêt (USD et EUR) sont deux autres facteurs clés augmentant le risque d’une longue récession. Toutefois, aussi bien le Fonds Monétaire International (FMI) que la Banque Centrale Européenne (BCE), avaient indiqué, à la réunion annuelle du WEF à Davos en 2022, que la récession mondiale serait évitée mais que les risques de stagflation doivent être pris sérieusement en compte.
Au chapitre de la mondialisation, définie comme étant la libre circulation des capitaux, des biens et services, et de l’information avec une mobilité humaine sélective, les experts du WEF convergent vers le fait que :
- La mondialisation durable encadrée par des nouvelles règles des 3M (Market, Money, Mobility) est nécessaire pour faire face aux défis mondiaux.
- La délocalisation par le « near-shoring » et le « friend-shoring » des chaînes d’approvisionnement s’accélèrent pour les États-Unis et l’UE, mais l’objectif d’une « autonomie » complète est illusoire, un monde autosuffisant en blocs est un monde beaucoup plus dangereux et moins innovant.
- La militarisation de l’alimentaire, des êtres humains (flux de migrants), et des systèmes financiers (sanctions) est à contenir.
- Plus de coopérations multilatérales sont nécessaires pour relever ces défis.
En ce qui concerne le « choc des matières premières », les experts du WEF avaient relevé que :
- La faiblesse critique des stocks d’énergie et de métaux menace à la fois la reprise économique et la transition énergétique ;
- Le manque d’investissements dans l’amont de l’industrie pétrolière et gazière a entraîné la limitation actuelle de la capacité de montée en puissance ; l’accord OPEP+ touche à sa fin mais il reste très peu de capacités pour augmenter la production ;
- Le danger de pénurie alimentaire mis en évidence compte tenu du blocage des exportations des céréales de la Mer Noire, des turbulences récurrentes dans le Golfe d’Aden, et de l’augmentation du coût des engrais et de l’énergie. Autour de 80 % de la population mondiale dépend des importations pour se nourrir. La situation s’est dégradée de manière drastique avec un risque de secousses sociales à l’image du « printemps arabe » de 2011 ;
- La volonté d’accélérer la transition énergétique en Europe afin de réduire la dépendance vis-à-vis de l’approvisionnement énergétique notamment russe ;
- La transition de l’Allemagne vers le gaz bon marché de substitution au gaz russe devrait prendre une décennie ;
- L’infrastructure d’hydrogène vert sera essentielle pour atteindre zéro émission nette mais couteuse.
- Les défis globaux actuels
Présentement, les défis globaux se déclinent en deux défis majeurs avec des impacts intra-états, inter-états et transnationaux. Il s’agit de :
- Défis non militaires :
— Mondialisation
— Droits de l’homme et inégalités
— Violence basée sur des conflits d’intensité variable
— Maladies et pandémies
— Dégradation de biodiversité
— Épuisement des ressources
— Développement durable et Changement climatique
— Génie génétique
— Cyber-sécurité
— Intelligence Artificielle
— Coopération internationale
- Défis militaires :
— Prolifération des armes conventionnelles
— Prolifération des armes de destruction massive
— Développement des conflits d’intensités variables
3. Le continent africain face aux défis actuels
Un rapport du World Economique Forum élaboré en 2010 à l’issue du Forum de Davos de la même année, précisait qu’à partir de 2020, l’Afrique deviendra l’histoire de la croissance surprise des prochaines décennies. Poussés par des investissements soutenus et la demande en provenance d’autres marchés émergents, plusieurs pays d’Afrique subsaharienne entraîneront l’ensemble du continent vers une plus grande intégration économique. La communauté d’affaires du continent se joindra inévitablement à ce processus. Cette situation s’accentuera avec le temps du fait que l’Europe deviendra de plus en plus repliée sur elle-même (Euro centrique) tandis que l’économie de l’Est et du Sud de la Méditerranée deviendra la principale plaque tournante pour le commerce africain en pleine croissance et les investissements. Grâce à ces marchés potentiels nouveaux et dynamiques, les pays nord-africains notamment se désintéresseront progressivement des initiatives de l’UE. Avec l’augmentation de la coopération Sud-Sud, une nouvelle identité Sud Méditerranéenne se développera et la région s’érigera en puissance des marchés émergents de plus en plus influents avec une nouvelle génération d’élites gouvernantes bien consolidées.
L’Algérie, pour sa part, avec sa perspective d’adhésion à divers groupes plurilatéraux compte s’ériger en interface géoéconomique en Méditerranée Occidentale et en Afrique sub-saharienne avec son triple levier : Gaz Energies Renouvelables, Minerais Stratégiques et critiques, Agriculture. A travers des projets structurants, l’Algérie entend donner la priorité aux pays de l’Afrique du Nord, notamment, la Mauritanie, la Libye et la Tunisie, ainsi qu’aux pays de l’espace Sahélo-saharien comme le Niger, le Mali, et le Tchad, et aux pays d’Afrique de l’Ouest comme le Nigeria et le Sénégal. Aussi, elle offre une ouverture aux pays africains, notamment, aux pays dits « Amis » tels que le Soudan, l’Éthiopie, l’Ouganda, le Kenya, le Mozambique, la Namibie et l’Afrique du Sud en accélérant la ratification et la mise en œuvre concrète de la Zone de Libre Echange Continentale Africaine (ZLECAf) en complément à la Grande Zone Arabe de Libre Echange (GZALE).
Au plan de la sécurité régionale, l’Algérie ne ménage aucun effort pour promouvoir la paix et la stabilité régionale par le dialogue et la médiation de réconciliation politique inclusive et de pacification des conflits d’intensité variables. L’Algérie continuera, indéniablement, à faire de de la lutte contre les multiples menaces dans la région du Sahel et de l’Afrique du Nord, une de ses priorités. Pour contenir ces fléaux, elle est activement engagée dans plusieurs actions multi-facettes de coopération et d’aide des pays de la bande Sahélo-saharienne, notamment, au développement économique de cette région frontalière avec la mise en place d’un fond d’Un milliard USD géré par l’Agence Algérienne de Coopération Internationale pour la Solidarité et le Développement et de la création de cinq zones économiques de commerce frontalier.
Dr. Arslan Chikhaoui